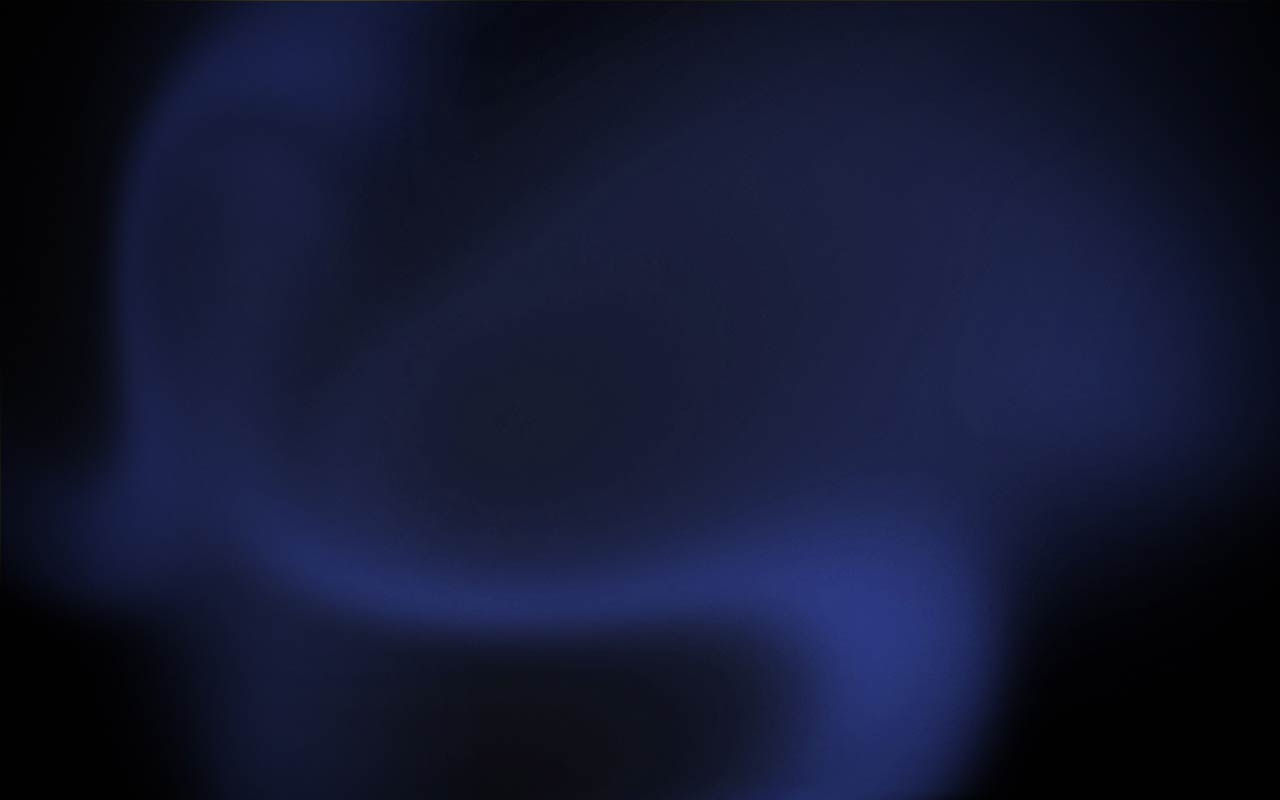
La Bible ou Le Coran ?
لا الكتاب المقدس أوو لو القرآن؟
Qui est le dernier prophète ? Jésus ou Mohammed ? من هو آخر نبي؟ يسوع أو محمد؟
L’exégèse moderne
Il y a cent cinquante ans, des exégètes autrichiens, voisins de l’empire ottoman, qui connaissaient les travaux et les méthodes appliquées à la Bible et aux Evangiles par leurs confrères allemands, s’intéressèrent au Coran. A leur suite, des chercheurs de plus en plus nombreux ont continué et prolongé ces travaux, en France, en Angleterre, puis aux Etats unis. Cette approche scientifique - une lecture critique des textes - a été appliquée à des éléments de l’histoire islamique de plus en plus nombreux, au Coran, à la vie de Mahomet et aux autres écrits de l’islam.
Des sources nouvelles
Des historiens explorent depuis le dernier quart du 20ième siècle, dans un contexte d’expansion des connaissances, des sources contemporaines de Mahomet, ou légèrement postérieures, qui n’avaient jamais été exploitées. Ces documents grecs, latins, hébreux, arméniens, géorgiens, syriaques ou persans, sont l’œuvre de chroniqueurs, de moines ou parfois d’évêques. Dans la plupart des cas ces auteurs rendent compte des événements qui se déroulaient dans leur région. Ils y mentionnaient souvent les activités de sectes diverses qui pullulaient alors au Proche Orient et, parmi celles-ci, le mouvement qui allait donner naissance à l’islam. Ces textes comportent des allusions, des éléments descriptifs ou des anecdotes concernant les croyances, les pratiques, les actes et les guerres des adeptes de Mahomet. Les éléments d’information qu’ils contiennent sont d’autant plus crédibles qu’ils datent des débuts de l’islam ou d’immédiatement après, et non deux siècles plus tard. Ces informations sont généralement des remarques incidentes noyées dans une prose foisonnante. Elles sont le plus souvent exposées sans volonté polémique et ne concernent l’histoire de l’islam que de manière très secondaire.
Trouver ces informations suppose un travail de lecture et de traduction considérable. Il faut pour cela lire des centaines ou des milliers de pages sans être assuré de trouver quoi que ce soit d’utile. La récolte se limite à des paragraphes de quelques lignes perdus dans d’énormes volumes en syriaque, géorgien, grec ou latin ! Mais ces bribes d’information non intentionnelles sont extrêmement précieuses. Par exemple, trouver dans quatre textes totalement différents, dont trois ont été écrits moins de dix ans après les faits, des phrases mentionnant que Mahomet commandait l’armée musulmane à la bataille de Gaza en 634 permet de se poser des questions sur les raisons qui ont conduit les historiens califaux, deux cents ans plus tard, à affirmer que Mahomet est mort en 632.
Un pré-islam
Le point de vue musulman est qu’il y a eu une lignée de prophètes, dont Mahomet est le dernier. Comme les hommes oublient, Allah a envoyé une succession de prophètes, dont Mahomet est le dernier, pour faire des "rappels". Il y a eu cinq révélations majeures : celle d’Adam, qui a reçu l’intégralité du Coran, mais qui ne l’a pas mis par écrit, de sorte que cette révélation est perdue. Moïse a ensuite reçu le Coran, mais les juifs ont falsifié son écrit, ce qui explique que la Tora soit différente du Coran. David l’a reçu de nouveau, mais son écrit est entièrement perdu. Jésus l’a reçu également, mais les chrétiens ont falsifié les Evangiles, ce qui explique que les Evangiles soient différents du Coran. Enfin Mahomet l’a reçu, sa révélation a été mise par écrit avec exactitude, et ne s’est pas perdue.
Dans ces conditions, il est concevable que les révélations antérieures à Mahomet puissent avoir laissé quelques traces, ce qui explique que l’on puisse retrouver des éléments de la doctrine islamique avant Mahomet.
Le point de vue des historiens modernes est que les grandes novations, en religion, en philosophie, ou en tout domaine, sont préparées par des ébauches et des préparations, de sorte qu’il est envisageable de trouver dans les siècles qui ont précédé l’islam des éléments de sa doctrine.
Pour les uns comme pour les autres, il est acceptable, et éventuellement intéressant, de chercher s’il a existé un pré-islam identifiable.
Les écrits d’historiens, de chroniqueurs romains, juifs ou chrétiens, de moines, évêques et autres membres du clergé, les documents produits par les sectateurs juifs et chrétiens qui ont opéré au Proche Orient entre le 2ième siècle avant notre ère et le 3ième après, c’est à dire entre huit cents et quatre cents ans avant l’origine de l’islam, sont riches de découvertes et d’enseignements.
Ces auteurs décrivent, avec plus ou moins de précision, les innombrables conflits théologiques, le credo, les pratiques rituelles des multiples groupes, sectes, écoles de pensées qui prévalaient à cette époque dans cette région.
Ils nous font connaître ce que les sociologues d’aujourd’hui nomment les mouvements millénaristes et messianistes qui ont vu le jour peu avant ou peu après le premier siècle. Certains se sont maintenus de manière plus ou moins larvée ou à peine modifiée pendant des siècles. L’étude de ces documents permet de suivre à la trace les permanences et les évolutions de certains d’entre eux dont la théologie est étrangement proche de celle de l’islam d’aujourd’hui.
Un exemple : les thématiques théologiques si particulières des "guerres juives" dans la Palestine romaine, décrites par Flavius Joseph et d’autres auteurs, conduites par des sectes en rupture avec l’orthodoxie judaïque, ont survécu et évolué de siècle en siècle depuis leur origine ; une bonne part de leurs croyances, de leurs légendes, de leurs pratiques se retrouvent dans l’islam aujourd’hui, notamment l’idée qu’une communauté protégée par Dieu allait, par les armes, dominer le monde pour y établir une société où régneraient le bonheur et l’abondance, au seul profit des Justes, les adeptes de la nouvelle religion. Quant à ceux qui refuseraient de se convertir, les Injustes, ils seraient affligés d’un statut inférieur. Ces idées se retrouvent aujourd’hui dans les concepts de djihad et de dhimmis, et dans la pratique des sociétés musulmanes depuis quatorze siècles.
Les nouveaux outils
Le quatrième facteur qui permet d’approcher de plus près la vérité historique est le développement de techniques et de disciplines créées il y a plus d’un siècle. Pour l’islam, elles ont produit une moisson de résultats nouveaux seulement dans le dernier quart du 20ième siècle et surtout au début du 21ième. Ceux-ci apportent des éléments de preuve ou des compléments d’information sur les faits historiques. Les plus importantes sont l’onomastique, étude des noms propres ; la toponymie, étude des noms de lieux ; l’épigraphie, étude des inscriptions dans la pierre ; la linguistique, en particulier à partir du syro-araméen ; la numismatique, et l’archéologie.
Une nouvelle voie de recherche
Certaines idées incluses dans l’islam contemporain sont présentes dans le messianisme et le millénarisme judéo-chrétien qui ont vécu leur âge d’or durant le premier et le deuxième siècle après J.C. Il est intéressant de chercher par quel chemin ces idées anciennes ont rejoint l’islam d’aujourd’hui.
La Bible ou le Coran ? La Bible ou le Coran ? La Bible ou le Coran ? La Bible ou le Coran ? La Bible ou le Coran ?