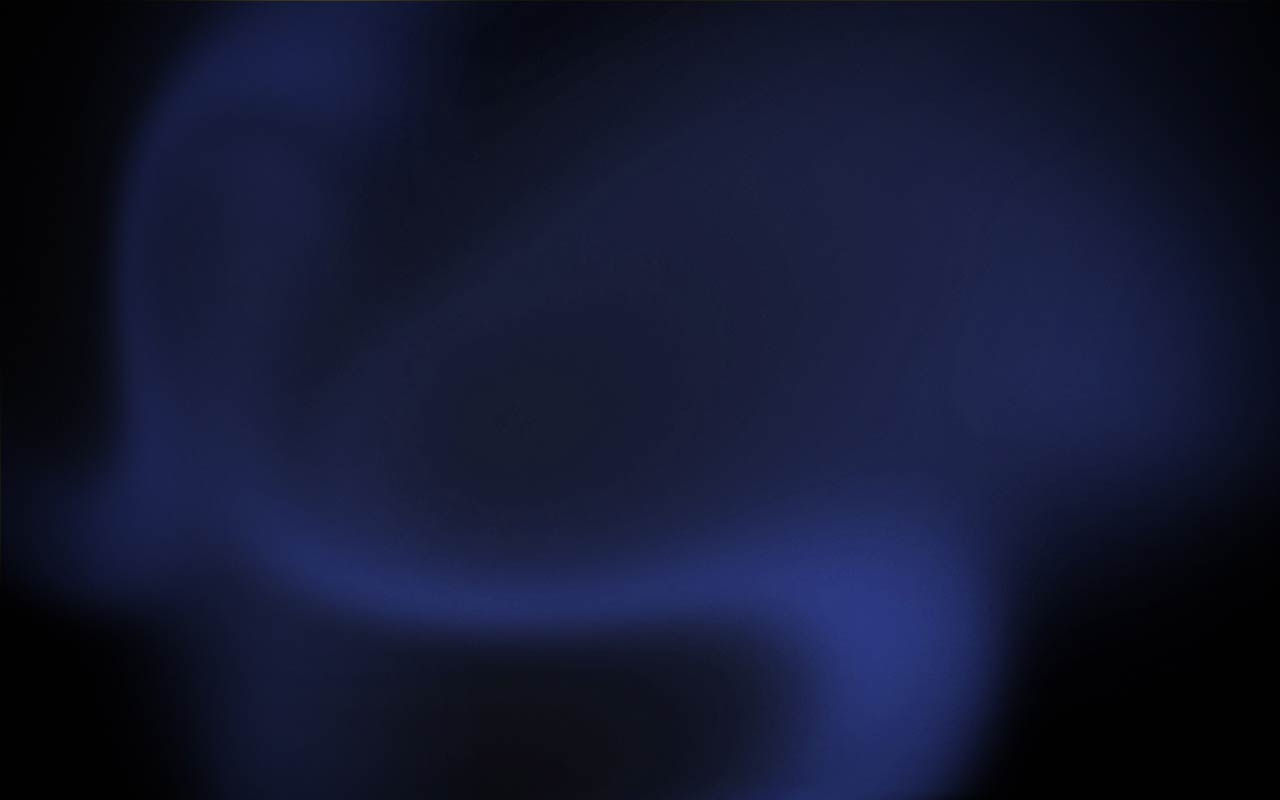
La Bible ou Le Coran ?
لا الكتاب المقدس أوو لو القرآن؟
Qui est le dernier prophète ? Jésus ou Mohammed ? من هو آخر نبي؟ يسوع أو محمد؟
Les religions dans le monde moderne
La Bible et les Evangiles, l’histoire du judaïsme archaïque et de la première église chrétienne ont été passés au crible de la critique historique, et toutes les méthodes modernes d’exploration du passé ont été mises à contribution pour comprendre ce qui s’est passé, et comment ces textes ont été constitués.
Les mêmes démarches sont maintenant appliquées à l’islam. On peut se faire une idée de ce qu’elles produiront en regardant leurs effets sur le judaïsme et le christianisme.
Quelques juifs et quelques chrétiens, particulièrement parmi les traditionalistes, effrayés de ce que l’usage des méthodes scientifique pouvait amener, se sont élevés contre leur emploi dans le domaine religieux. Leur opposition a été vaine : il est aujourd’hui impossible d’interdire à la science d’appliquer ses méthodes à quelque domaine que ce soit, et notamment pas à l’étude historique de la formation des religions. Les craintes exprimées se sont d’ailleurs montrées excessives. Le judaïsme et le christianisme ont bien sûr dû changer certaines idées naïves sur leur formation, mais ces recherches et les découvertes qu’elles ont produites ont été finalement avantageuses pour ces religions, car leur histoire est devenue mieux assurée, bien que sur certains points différente de ce que l’on croyait.
Ce travail commence seulement pour le Coran et pour les débuts de l’islam. L’exégèse moderne, développée pour l’étude du christianisme et du judaïsme, a certes été appliquée à l’islam et au Coran depuis déjà un siècle et demi, mais c’est depuis une quinzaine d’années seulement que des percées décisives ont été réalisées, grâce à une pluralité de méthodes nouvelles. Aujourd’hui, les connaissances sur la formation du Coran et les débuts de l’islam deviennent ce qu’elles sont depuis longtemps pour le judaïsme et le christianisme. Naturellement, certains musulmans s’effraient aujourd’hui, comme des juifs et des chrétiens se sont effrayés jadis. C’est une réaction naturelle devant les changements, une réaction que nous partageons tous à une époque où la rapidité des évolutions devient un torrent qui emporte bien des symboles chéris dans notre enfance. Il vaut mieux cependant comprendre les travaux d’aujourd’hui plutôt que refuser d’en prendre connaissance. Les juifs et les chrétiens tentés par le refus se sont marginalisés, ceux qui ont accepté l’usage universel de la science sont entrés dans le monde moderne.
Les musulmans sont aujourd’hui devant le passage que les juifs et les chrétiens ont dû franchir il y a plusieurs générations. Un monde nouveau, celui du troisième millénaire, les attend de l’autre côté. Il n’y a pas de raison que les musulmans soient plus réfractaires à la science que les juifs et les chrétiens ne l’ont finalement été.
Les documents disparus
L’histoire de l’islam des premiers temps, et particulièrement l’élaboration du Coran, telle qu’elle est racontée aujourd’hui par les théologiens, chefs de guerre, islamologues et historiens musulmans contemporains s’appuie sur des documents des 8ième et 9ième siècles, dont la quasi totalité date de plus de deux siècles après la mort de Mahomet. Tous les documents antérieurs ont disparu, alors que l’on a des preuves de leur existence par des citations qui ont subsisté dans des ouvrages ultérieurs. De plus un grand nombre de ces documents disparus ne provenait pas de témoins oculaires mais de chaînes de transmission orale appelées isnâd : Ahmed a entendu dire par Brahim, qui le tenait de Mustapha, etc. De ces témoins successifs, on ne sait le plus souvent strictement rien.
Si d’aventure un historien moderne voulait faire preuve d’autant de rigueur dans le traitement des sources historiques de l’islam qu’il est de coutume de le faire pour les sources européennes, japonaises ou indiennes, il devrait écarter toutes celles qui comportent des contradictions. Elles sont si nombreuses dans les sources historiques musulmanes que l’histoire de l’islam des débuts et celle de Mahomet en particulier se réduirait à quelques pages. Selon une formule classique, en matière islamique, ou bien on fait une critique des sources et on n’écrit pas l’histoire, ou bien on ne fait pas la critique des sources et l’on écrit "des histoires". Harald Motzki résume ainsi la situation [1] :
"D’un côté, il n’est pas possible d’écrire une biographie historique du Prophète sans être accusé de faire un usage non critique des sources ; tandis que d’un autre côté, lorsqu’on fait un usage critique des sources, il est simplement impossible d’écrire une telle biographie."
Alfred Louis de Prémare constate [2] :
"Toute biographie du prophète de l’islam n’a de valeur que celle d’un roman que l’on espère historique."
Lorsque l’on cherche à comprendre la formation de l’islam, on se heurte à certaines restrictions bien difficiles à admettre : le Coran est intouchable ; il est interdit à tout musulman de discuter de religion avec un non musulman. La théologie et l’histoire de l’islam sont auto-référentes : pour comprendre et interpréter un passage du Coran, connaître l’histoire de Mahomet et de l’islam, il n’est permis d’utiliser qu’un autre passage du Coran, ou des hadiths, ou d’autres textes de la théologie musulmane. Il est interdit de faire usage de textes non musulmans.
Dans une large partie du monde, celle qui est développée, il est désormais possible de ne pas se plier à ces restrictions, qu’ont respectées non seulement les croyants musulmans, mais aussi bien des islamologues, et d’espérer faire mieux qu’un roman historique.
[1] Harald Motzki, The Biography of Muhammad. The Issue of the Sources. Introduction, Bleyde-Boston-Cologne, Brill Academic Publisher, 2000.
[2] Alfred-Louis de Prémare Les fondations de l’islam, Le Seuil, Paris, 2002
La Bible ou le Coran ? La Bible ou le Coran ? La Bible ou le Coran ? La Bible ou le Coran ? La Bible ou le Coran ?